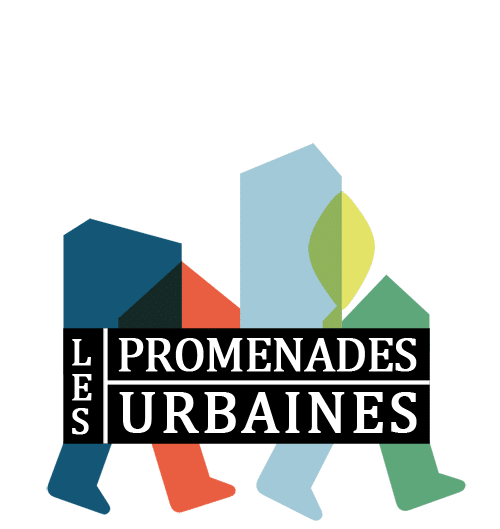Promenades dans la littérature et le cinéma
La Banlieue
Par Émile Zola (extrait de Le capitaine Burle, 1883)
Promenades dans la littérature et le cinéma
La Banlieue
Par Émile Zola (extrait de Le capitaine Burle, 1883)
Les Parisiens montrent aujourd’hui un goût immodéré pour la campagne. À mesure que Paris s’agrandi, les arbres ont reculé, et les habitants, sevrés de verdure, ont vécu dans le continuel rêve de posséder, quelque part, un bout de champ à eux.
Les plus pauvres trouvent le moyen d’installer un jardin sur leurs fenêtres ; ce sont quelques pots de fleurs qu’une planche retient ; des pois de senteur et des haricots d’Espagne montent, font un berceau. On loge ainsi le printemps chez soi, à peu de frais. Et quelle joie, lorsqu’on a des fenêtres ouvrant sur un des rares jardins que la pioche des démolisseurs à épargnés ! Mais le plus grand nombre désespère de cette heureuse chance. Le dimanche, la population, qui étouffe, en est réduite à faire plusieurs kilomètres à pied, pour aller voir la campagne, du haut des fortifications.
Cette promenade aux fortifications est la promenade classique du peuple ouvrier et des petits bourgeois. Je la trouve attendrissante, car les Parisiens ne sauraient donner une preuve plus grande de leur passion malheureuse pour l’herbe et les vastes horizons.
Ils ont suivi les rues encombrées, ils arrivent éreintés et suants, dans le flot de poussière que leurs pieds soulèvent ; et ils s’assoient en famille sur le gazon brûlé du talus, en plein soleil, parfois à l’ombre grêle d’un arbre souffreteux, rongé de chenilles. Derrière eux, Paris gronde, écrasé sous la chaleur de juillet ; le chemin de fer de Ceinture siffle furieusement, tandis que, dans les terrains vagues, des industries louches empoisonnent l’air. Devant eux, s’étend la zone militaire, nue, déserte, blanche de gravats, à peine égayée de loin en loin par un cabaret en planches. Des usines dressent leurs hautes cheminées de briques, qui coupent le paysage et le salissent de longs panaches de fumée noire.
Mais, qu’importe ! par delà les cheminées, par delà les terrains dévastés, les braves gens aperçoivent les coteaux lointains, des prés qui font des taches vertes, grandes comme des nappes, des arbres nains qui ressemblent aux arbres en papier frisé des ménageries d’enfant ; et cela leur suffit, ils sont enchantés, ils regardent la nature, à deux ou trois lieues. Les hommes retirent leurs vestes, les femmes se couchent sur leurs mouchoirs étalés ; tous restent là jusqu’au soir, à s’emplir la poitrine du vent qui a passé sur les bois. Puis, quand ils rentrent dans la fournaise des rues, ils disent sans rire : « Nous revenons de la campagne. »
[…]
Le cri de Paris est un continuel cri de liberté. La ville craque dans sa ceinture trop étroite ; elle regarde sans cesse à l’horizon, essoufflée, demandant du soleil et du vent. Son rêve semble être de changer la plaine en un jardin de plaisance, où elle se promènerait le soir, après sa besogne achevée. C’est une poussée universelle qui va grandissant chaque année, et qui finira par faire de la banlieue un simple prolongement de nos boulevards, plantés d’arbres maigres.
Texte complet ICI (pages 191 à 204)